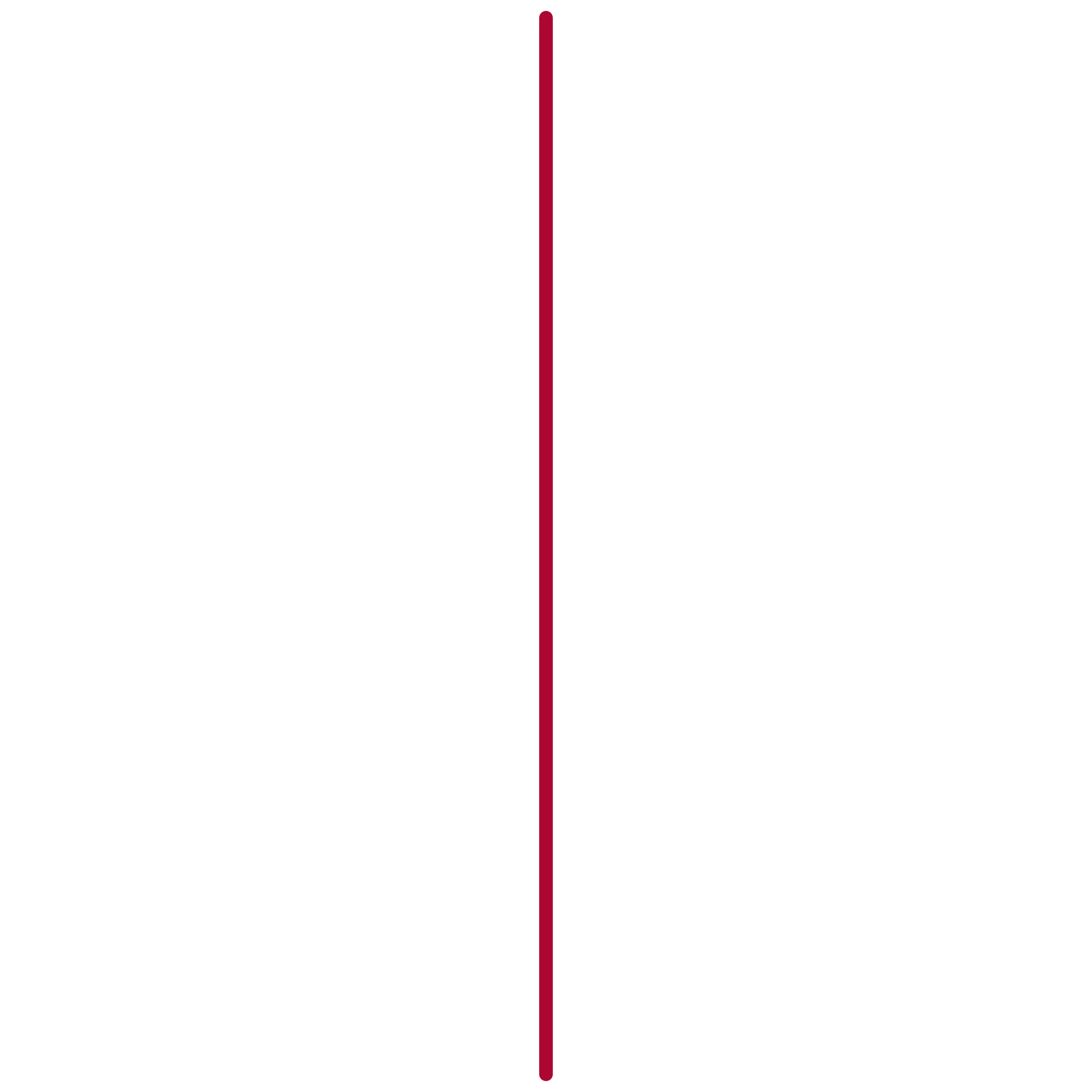Que sont devenues les éditions du Ver à Soie au bout de 3 ans ?
Au bout de 3 ans, j’ai presque 20 titres au catalogue et petit à petit, il y en a toujours un peu plus. Ce n’est pas la réussite (ou pas) façon startup, mais c’est régulier. Quand je suis sur un marché l’été, il y a au moins 3000 personnes qui voient ou prononcent Le Ver à Soie : c’est mon plan communication, qui aurait coûté super cher conçu par un professionnel.
Moi, je veux me créer un métier et pouvoir en vivre dans quelques années. Depuis que j’ai créé Le Ver à soie, j’ai rencontré beaucoup des gens qui avaient aussi rompu avec le monde du salariat et entamé une reconversion complète.
Beaucoup d’éditeurs indépendants se considèrent comme des artisans libres d’eux-mêmes et créent leurs petits jardins en privilégiant la qualité sur la quantité.
Il y en a beaucoup qui sont des rebuts surdiplômés de l’Education Nationale et de la recherche. J’ai beaucoup de collègues docteurs, dont un docteur en physique nucléaire ! Il y en a qui viennent du monde de l’édition, et enfin d’autres avaient une passion et ont souhaité la partager.
Quelles sont les relations avec les auteurs ?
Je ne prends pas les textes qui auraient besoin d’un travail de coach en écriture car je ne conçois pas le métier d’éditeur comme un coach en écriture. Je n’en ai pas le temps. Je sélectionne les textes terminés, qui entrent dans ma ligne éditoriale : le voyage, la quête, l’exil, le sentiment d’exil, du post-exil. Et surtout, je dois sentir que je peux défendre le livre, car c’est moi qui vais le vendre. Pour l’instant, je travaille sur un rythme de 4 à 5 livres par an. Mon idée est de construire mon petit jardin avec des palettes de tons différents autour de ma ligne éditoriale.
Quel est votre meilleur souvenir ?
La sortie de mon premier livre chez l’imprimeur. Après ces deux années de lutte et 13 années de chômage, j’avais enfin réussi à faire quelque chose qui me ressemblait.
Et votre pire ?
C’est celui a inspiré votre titre ! J’entre dans une librairie, la propriétaire prend un livre jeunesse, un des premiers que j’ai édités. Elle le casse sous mes yeux en disant que, comme il ne rentre pas dans ses étagères, cela lui donne envie de casser sa beauté. Cela a été plus qu’une gifle, c’était proche du coup de poignard. Tout était dit dans cette phrase, cette attitude, cette manière de traiter les indépendants quand on est dans une pensée de la grande distribution : on va vous casser votre beauté pour que vous entriez dans nos putains d’étagères. Non seulement on a envie, mais on le fait. On prend ce qui ne nous appartient pas, et on le casse s’il faut. La lutte, c’est donc de continuer à faire de beaux objets avec amour, avec de l’humain, avec des gens qui y ont mis leur cœur. Cela résonne à plusieurs degrés : moi qui suis d’origine biélorussienne, quand j’allais en ex-Urss et que je regardais certaines architectures, je me disais » Pourquoi tout ce qui doit être accessible à tous doit être aussi laid ? » Aujourd’hui, on est dans un système où on nous incite à faire de la mal-édition comme on fait de la malbouffe, de la mal-santé ou de la mal-éducation. Quand on arrive avec des livres un peu jolis et qui sortent des formats et du pelliculage ordinaire, on est tout de suite repéré comme quelqu’un d’atypique qui va poser problème. Ce n’est pas spécifique à l’édition.
Etre une femme, est-ce un atout ou un frein ?
C’est dix fois plus difficile. Quand j’ai voulu avoir une carte de commerçant non-sédentaire, cela a pris six mois, car mon nom d’épouse était différent de mon nom de naissance. Comme j’avais déclaré mon auto-entreprise sous mon nom de naissance, cela a été super compliqué et rocambolesque administrativement.
De même, les banquiers masculins m’ont rendu mes démarches beaucoup plus difficiles.
Une histoire qui dit tout : quand je posais une question simple à un homme, par exemple « Quelles démarches faut-il faire pour pouvoir faire les marchés à Charenton ? », l’homme me répondait : « Vendre des livres, cela ne va pas marcher ». Quand on est une femme et qu’on pose une question précise, on obtient presque systématiquement d’abord une réponse inadéquate et qui fait donneur de leçon. Au fond, la première chose qu’on vous dit, c’est que vous allez échouer. Au bout d’une semaine de rappels, j’ai eu l’idée de demander à mon mari s’il voulait bien me prêter sa belle voix grave, et à ses questions précises, il a immédiatement obtenu des réponses précises. Pourquoi ? On peut faire plein d’hypothèses. Le résultat, c’est qu’en tant que femme, on est moins considérée et qu’il faut dépenser trois fois plus d’énergie. Le conseil que je donne, pour ne pas perdre de temps, est de louer une doublure homme pour poser ses questions !
Le site du Ver à Soie : https://www.leverasoie.com/boutique/index.php/les-collections
Mon dernier article « Socrate avait-il un coach ? Regards croisés sur le métier de coach«